|
 |

|
Le
monde des algues
Texte de Renaud Burrowes,
illustrations de Frédérique Fernandez
La Garance voyageuse n° 57 |
Au-delà des
macro-algues d'eaux douces ou salées, bien
connues de tous, les algues présentent une
formidable diversité que ce soit par le nombre
d'espèces ou par leur forme et leur biologie.
Rencontre avec des végétaux bien étonnants...
.
Apparues, il y a probablement plus de trois milliards
d'années, des algues (les algues bleues) furent
les premiers organismes photosynthétiques présents
à la surface du globe. D'abord microscopiques, les
algues
ont évolué vers des formes plus complexes pour atteindre
aujourd'hui un niveau de diversité élevé : on compte
environ 30 000 espèces actuellement réparties en
11 embranchements. |
 |
 |
| |
|
Alaria
esculenta (L.) Greville
est une espèce
comestible du littoral de l'Atlantique Nord |
Les "algues" : une grande
variété de formes et de tailles
Les algues peuvent être définies comme des organismes
photosynthétiques, n'ayant pas de véritable tige, racine,
feuille ou tissus conducteurs, dont les cellules reproductrices
sont produites dans des "cystes" et qui ne produisent
pas de fleur. Elles sont généralement inféodées aux milieux
humides bien qu'on puisse en trouver à peu près partout,
même dans des milieux particulièrement hostiles (déserts,
glaciers...). Cette définition reste cependant très vague,
car on trouve groupés sous l'appellation d'algues, des
organismes eucaryotes (dont les cellules possèdent un
noyau) ou procaryotes (dont les cellules ne possèdent
pas de noyau), uni ou pluricellulaires, solitaires ou
coloniaux, mobiles ou fixés, comestibles ou toxiques et
qui ont colonisé tous les milieux. Leur taille varie de
moins d'un micron (0.6 µm pour l'algue bleue Prochlorococcus)
à plusieurs dizaines de mètres (l'algue brune Macrocystis
peut mesurer 45 m, soit 85 millions de fois plus grand
que Prochlorococcus ! ).

 |
Le genre
Macrocystis regroupe les plus grandes algues du
monde
qui poussent surtout en zone subantarctique et en
Californie.
Ici, Macrocystis integrifolia Bory de Saint-Vincent. |
De plus, dans le langage courant on regroupe sous le terme
d'algues des organismes qui n'ont pas de lien de parenté
direct : une ulve (algue verte) est beaucoup plus proche
phylogénétiquement d'un pommier que d'une laminaire (algue
brune) ce qui n'empêche pas de considérer l'ulve et la
laminaire comme des algues en raison du partage de nombreux
caractères. Les algues ne constituent donc pas un groupe
naturel et sont dispersées sur les différentes "branches"
de "l'arbre de la vie". Nous traiterons, ici essentiellement,
des trois groupes de macroalgues susceptibles d'être récoltées
par les promeneurs à marée basse : les "algues brunes"
ou Phéophycées, les "algues rouges" ou Rhodophycées et
les "algues vertes" qui appartiennent à plusieurs groupes
systématiques dont certains contiennent également les
mousses, les fougères et les plantes à fleur. Nous mentionnerons
néanmoins les "algues bleues" ou Cyanobactéries et un
groupe que nous nommerons ici les "autres algues microscopiques"
qui inclue plusieurs embranchements aux noms plus ou moins
barbares (Glaucocystophyta, Cryptophyta, Dinophyta, Chlorarachniophyta...)
qu'il nous est impossible d'aborder en détail, mais qui
ne peuvent être ignorés en raison du rôle écologique ou
économique fondamental de certains d'entre eux comme,
par exemple, les diatomées.

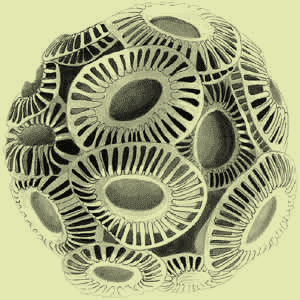 |
Algue
phytoplantonique (Coccolithophoridée), grossie1200
fois.
Les Coccolithophoridées faont 7 à 15 microns de
diamètre et vivent
un peu partout au large des côtes mais surtout en
zone tropicale. |
Contrairement à une idée reçue, il n'y a aucun lien direct
entre la couleur d'une algue et son appartenance à tel
ou tel embranchement. Une "algue bleue" peut être de couleur
noire ou rouge et certaines "algues rouges" ont une fâcheuse
tendance à avoir une couleur plus ou moins brunâtre, voire
franchement verte. En fait on ne peut classer une algue
avec certitude qu'après un examen microscopique attentif
nécessitant une étude approfondie de sa croissance, de
sa reproduction et de sa cytologie (étude de la structure,
des propriétés, de l'activité et de l'évolution des cellules
vivantes) par l'utilisation de colorants spécifiques.
De même, l'idée selon laquelle les algues se répartissent
sur l'estran en ceintures successives selon un gradient
surface-fond (vertes, puis brunes, et rouges) en réponse
à une variation de la quantité de lumière reçue doit être
abandonnée. Il suffit d'ailleurs d'observer une flaque
d'eau à marée basse pour constater qu'elle héberge différents
embranchements d'algues. En effet, les algues ne se répartissent
pas uniquement en fonction de la quantité de lumière qu'elles
reçoivent, mais également en fonction de nombreux facteurs,
comme la compétition interspécifique, la prédation ou
leur plus ou moins grande résistance à l'émersion, aux
contraintes mécaniques du ressac et aux variations de
salinité.

Des algues dans nos assiettes...
Les algues constituent indirectement une part importante
de notre régime alimentaire. Les gélifiants et émulsifiants
que nous consommons quotidiennement dans les produits
laitiers sont des extraits d'algues. Par exemple, les
codes E 401 à E 405 apposés sur les étiquettes de crèmes
desserts correspondent à des alginates extraits d'algues
brunes (laminaires). Les gélifiants E 406 (agars) sont
extraits d'algues rouges du genre Gelidium et les carraghénanes
(E 407) sont extraits de Chondrus crispus qui pour cette
raison est appellé carragheen outre Manche ou goémon blanc
en Bretagne.
 |
Les
Himanthalia sont utilisés depuis peu dans l'alimentation
humaine
et commercialisés en France sous le nom de "haricots"
ou "spaghettis de mer". |

Dans certains pays asiatiques, des algues fraîches ou
séchées, riches en divers éléments tels que vitamines
et oligo-éléments sont à la base de nombreux plats traditionnels.
Chaque Japonais consomme environ 4 kg d'algues par an
et les noms commerciaux des espèces comestibles (Kombu
pour Laminaria, Nori pour Porphyra, Wakamé pour Undaria)
trahissent leur origine asiatique.
A côté de ces utilisations alimentaires, les algues sont
également à la base de nombreux produits cosmétiques et
thérapeutiques. Elles peuvent être utilisées pour traiter
des carences protéiques (Spirunina platensis, la célèbre
spiruline) ou des problèmes circulatoires (Delesseria
sanguinea). Leur forte teneur en iode permet leur utilisation
pour le traitement des carences en iode. La littérature
scientifique indique que plusieurs centaines d'espèces
d'algues pourraient renfermer des molécules ayant une
activité antibactérienne, antifongique, antitumorale ou
vermifuge. Elles sont également utilisées en grande quantité
en thalassothérapie et entrent dans la composition de
cosmétiques (crèmes, masques...). De manière plus anecdotique,
certaines algues sont capables de produire des hydrocarbures
(Botryococcus 6raunü) et d'autres sont utilisées en exploration
spatiale pour synthétiser l'oxygène indispensable aux
spationautes.
Face à tant de potentialités et de domaines d'utilisation,
il est compréhensible que beaucoup d'entreprises investissent
dans la culture de ces végétaux. Ainsi, sur le seul continent
asiatique, d'importantes surfaces côtières sont dévolues
à cette aquaculture.

 |
| Récolte
artisanale d'algues du genre Caulerpa en Asie. |
En 1994, 90 % des 7 637 721 tonnes d'algues fraîches utilisées
par l'Homme provenaient de cultures ; le reste des récoltes
se faisant directement dans le milieu naturel, notamment
en Bretagne, à l'aide d'un "scoubidou", sorte de bras
hydraulique dont sont équipés les bateaux goémoniers.
Certaines microalgues
peuvent être dangereuses...
En parallèle à ces utilisations, certains végétaux marins
peuvent présenter un dangre véritable pour l'Homme en
cas de proliférations massives appelées "bloom" ou "marée
rouge". Le groupe des Dinoflagellés (algues microscopiques)
contient à lui seul une cinquantaine d'espèces toxiques.
L'ingestion de fruits de mer ayant concentré des toxines
d'algues dans leurs tissus peut provoquer des symptômes
neurologiques, digestifs et musculaires pouvant entraîner
la mort. En eau douce également, lorsque les conditions
sont favorables, des microalgues toxiques prolifèrent,
provoquant des morts massives d'animaux et pouvant nuire
à la santé des baigneurs, les troubles allant de la simple
affection dermatologique à des lésions neurologiques ou
hépatiques irréversibles. Lorsque certains représentants
du groupe des Haptophytes prolifèrent, ils rejettent dans
l'atmosphère des substances chimiques (Di-Méthyl Sulfate)
en si grande quantité qu'elles peuvent provoquer des modifications
climatiques à l'échelle planétaire en agissant sur la
densité nuageuse.

 |
| Fucus
spiralis L. est une espèce marine courante
sur la côte atlantique européenne. |
Pour ce qui est des algues macroscopiques marines, leur
prolifération, même si les espèces impliquées ne synthétisent
aucune toxine, peuvent être nuisibles pour l'Homme. Par
exemple, les "marées vertes" fréquentes en Bretagne et
liées à l'utilisation massive d'engrais, sont néfastes
aux professionnels du tourisme, car la décomposition des
algues vertes échouées (plus de 40 000 m3 /an d'algues
du genre Ulva en Bretagne) est à l'origine de désagréments
visuels et olfactifs. Les opérations de "nettoyage"qui
s'en suivent causent également des déséquilibres écologiques.
La prolifération anarchique d'espèces introduites n'est
pas non plus sans conséquences sur l'environnement. Le
cas de la Caulerpa taxifolia en Méditerranée, largement
médiatisé, en est un exemple.
A ces nuisances viennent s'ajouter des cas d'algues parasites
d'animaux ou de végétaux terrestres. Des
genres tels que Astasia ou Parastasiella s'attaquent aux
Crustacés en infestant leurs tissus pour s'y reproduire.
Chez les plantes, des espèces économiquement
importantes, comme le théier ou le cacaoyer, sont
parasitées par le genre Cephtaleuros.
Un rôle primordial !
Finalement, même si certaines espèces peuvent s'avérer
nuisibles, il ne faut pas perdre de vue le rôle vital
que jouent les algues. Le phytoplancton (l'ensemble des
micro-algues en suspension dans l'eau) constitue à l'évidence
la plus importante machine à produire de l'oxygène du
globe et les "forêts d'algues" sont un lieu privilégié
pour la reproduction et la nutrition de beaucoup d'espèces
animales. Les algues sont également un sujet de recherche
scientifique très active, comme en témoigne la découverte
récente d'une classe de microalgues jusqu'alors inconnue
: les Bolidophycées...
|
